La mort du chroniqueur Pierre Foglia en juillet de cette année m’a profondément touché. Je l’aimais beaucoup. Foglia, par son écriture, a été un mentor pour moi. Suite à son décès, je voulais, comme tant d’autres, lui rendre hommage. Mais je voulais prendre mon temps, laisser passer la vague de superlatifs, aborder le sujet hors tempo, un peu à sa manière « à rebrousse-poil » qui le caractérisait. Je voulais surtout prendre le temps de choisir les bons mots. Le temps a passé et le projet a avorté. L’exercice m’est apparu trop difficile, je n’arrivais pas à m’enlever de l’idée le jugement impitoyable qu’il aurait eu sur des éloges aussi convenus. Je ne pouvais, à travers ce regard inventé, que me ridiculiser. J’allais donc passer à autre chose quand je me suis rappelé qu’en 2015 j’avais écrit un récit non publié qui parlait de lui, de son importance dans ma vie. Sachant que je n’ai pas écrit ce texte dans un contexte d’éloges funèbres, je me suis imaginé qu’il aurait pu le trouver acceptable. Je vous partage, ici, ce texte dont le titre fait référence à son premier métier qu’il a tant aimé.
LE TYPOGRAPHE
1980
J’habite avec mes parents sur une ferme dans un rang du Centre-du-Québec. Je tatoue les taures, je castre les porcelets, je traque les grenouilles dans le ruisseau en face de chez nous.
Et je lis Foglia.
Je grandis dans la plaine du St-Laurent; mes racines poussent partout sous les champs bordés d’origine. Je n’ai pas encore 15 ans, ni vraiment conscience de la première défaite, mais je lis Foglia tant que je peux. Je découvre un ton, une ironie, un regard toujours différent. Je m’identifie. Déjà.
1984
Mes parents se séparent. Du fond de ma chambre, dans la maison à vendre, je me protège de la tempête en dévorant le livre de cette année-là et en me gavant d’Olympiques de Los Angeles. Je me projette dans des fantasmes inouïs de barres asymétriques avec Mary Lou Retten, des scénarios avec Big Brother, les télés-écrans et la novlangue. Et le vieux chroniqueur est toujours là, avec ses chats, sa sensibilité qu’on devine à chaque chronique et que je ressens.
1995
J’habite Sherbrooke. Je suis un jeune sevré trop tôt qui patauge à l’université. Je tiens un journal que j’écris sur une machine à écrire électrique en plaçant ma feuille horizontalement sur le rouleau. Ça fait de longs paragraphes humides et mous créés dans une pétarade romantique. Je crois sottement que j’ai du style.
Un jour de cette année de non-pays, Foglia écrit une chronique dans laquelle il dit que Sherbrooke est une ville laide. Je suis une repousse fragile dans cette terre loyaliste. J’essaie d’écrire. J’écris Sherbrooke. Je m’arc-boute dans ses côtes, dérape dans ses bars, m’agrippe à sa gorge. J’ai besoin d’amour et d’appartenance. Je prends donc prétexte à sa charge pour dire au vieux que j’existe. Je défends mon refuge comme le dernier survivant en voulant répliquer dans les mêmes formes que lui parce qu’au fond je l’aime et je veux qu’il m’aime. Quelle humiliante affaire! Je prends mille heures pour écrire une lettre pathétique. À la dernière phrase, je laisse une faute d’orthographe grosse comme une poutre.
1998
J’habite toujours Sherbrooke. J’écris encore mon journal, mais sur un ordinateur qui couine comme une souris au fond d’un seau vide. J’ai perdu ma blonde dans mes phrases creuses au sortir du grand verglas. J’écoute Dead Can Dance dans un appart de mort. Mais le plus dur, peut-être inconsciemment, c’est le référendum perdu trois ans auparavant. Coulé dans la boue, déprimé -déjà- par le siècle à venir, j’écris une autre lettre à l’hypocondriaque. Un flash. Une vision d’abandon, d’orphelinat collectif. Je pressens qu’il nous faudra sa voix dans ce qui s’en vient, son intelligence comme dernier rempart aux hypocrisies toujours plus sournoises, aux vérités qui n’en sont pas. Je lui écris que j’ai peur qu’il meure… Bravo champion! Surprise : il ne répond pas.
Ma quête de reconnaissance s’entortille comme ça, tranquillement, à travers mon écriture de serpent autophage et la sienne belle, directe et simple, comme la vie. Je me fantasme une histoire avec lui, une conscience commune. Et puis je l’admire. Je le prends pour un grand artiste et j’aime son humilité (comme celle de René Lévesque). Il est là, dans mes champs d’enfance, dans mes origines.
Je le mythifie.
Et le nouveau siècle arrive. Et l’âge adulte. Et le couple. Et le fils. Et ça change tout. Le pays est perdu, alors mourrons de mort vivante. L’écriture prend le bord alors que le fils se retrouve dans mes bras. La vaisselle s’accumule, le bois à rentrer, les poubelles, l’épicerie. Les jours sont faits de mille interruptions domestiques. Je promène le fils sur le porte-bébé, au bord de la rivière, sur la route du village. Il grandit. Il est maintenant dans mon pas. À l’ordi, il pianote déjà, il parle aussi : C’est grand-papa? Non, fils, c’est un monsieur qui écrit que tu vois là sur l’écran.
2008
J’habite Racine (clin d’œil toponymique). Je suis bien accroché à mes nouvelles terres. Je suis installé dans la colline, je sillonne le pays estrien sur mon vieux vélo hybride. Je bois aux paysages. C’est l’année des Olympiques de Pékin, Foglia y sévit. Ce n’est pas le bon mot. Il s’y ouvre. Il y aime. En Chine, son lyrisme éclate en textes sensibles, intimes et amoureux. Le pays et ses gens le touchent au cœur. Il est heureux; il ne le dit pas, on le sent. Le bruit agressant du siècle se tait en lui, il murmure la vie, l’humanité. Il est vrai. Il est fragile. Mon histoire avec lui continue.
2010
J’assiste au premier Grand Prix cycliste de Montréal; les meilleurs au monde sur la montagne. Je me poste dans la Camilien Houde pour voir ces machines sur le bord d’exploser. Je suis ébahi par leur cadence maintenue dans les plus forts pourcentages. Je me projette en eux; je suis dans le flash blanc de leur souffrance. Ils passent. Je me retourne et Foglia est là, qui se promène dans sa veste tricotée, l’air doux, bienveillant, rien à voir avec l’image caustique qu’on s’en fait. C’est la rencontre réelle. Je me dirige vers lui, lui tends la main. Je lui déballe tout : mon admiration, mon fils qui l’appelle grand-papa, ma peur qu’il meure, mon amour, tout. Je suis fébrile. Il rit et me demande une prédiction pour la course. Je n’en sais rien. Il me quitte, l’air un peu de dire : ils n’y connaissent rien ces ploucs. Quelques jours plus tard, je lui écris. En gros, je lui parle de mon lien compliqué avec l’écriture. Je ne sais pas pourquoi je m’enfonce comme ça.
Foglia me répond cette fois-ci. Il m’écrit : Ne vous posez pas de question sur votre écriture, sur votre fragilité, sur votre capacité, écrivez. Parfois les rêves se réalisent, mais l’impact est à peine perceptible et long à venir.
2015
Je dévore les routes sur des milliers de kilomètres. Je suis un cycliste de route performant. Je cherche les montées les plus agressives, j’allonge mes parcours, je tiens des statistiques. Je ne sais pas pourquoi je fonce autant. L’impression d’une fuite en avant. Je roule sur le chemin de l’église à Bonsecours. Je pense à mon père qui s’efface peu à peu dans la maladie de l’oubli, à mon fils qui grandit dans un monde d’écrans qui m’échappe. Je vais avoir 50 ans. Je me sens largué.
Foglia prend sa retraite cette année-là. Ses mots de typographe ne sont plus sur la page parce que la page n’existe plus. Il part juste avant que le rien s’installe définitivement. C’est le départ le plus artistique que l’on puisse imaginer. Il manque à nos vies. Il me manque.
Aujourd’hui, je termine ce texte. Demain, j’écrirai encore. Je vous remercie pour tout, Monsieur Foglia. Tiens, je vous invite dans mon pays, on ira pédaler jusqu’au sommet du chemin Malboeuf. Vous verrez comme c’est beau. On entrera tous les deux en silence dans le paysage.












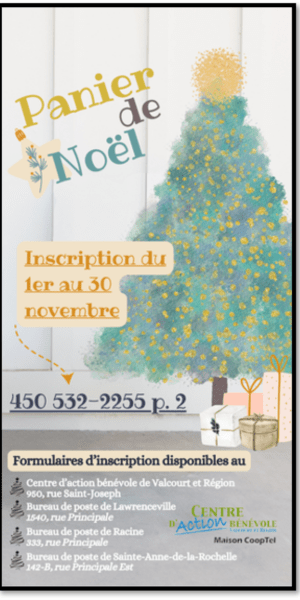

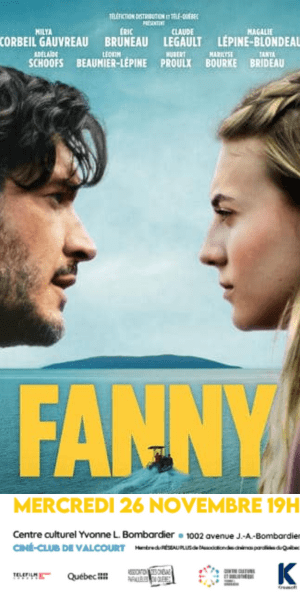



1 commentaire
Renelle Jeanson
J’aime te lire.
Merci du partage et ne lache pas.